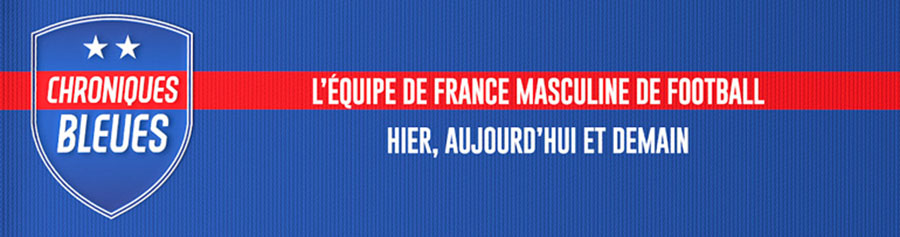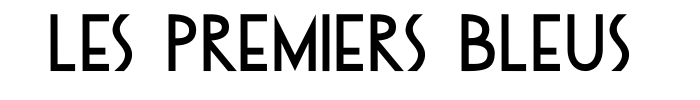En dehors du stade, le sport s’est d’abord vécu à travers la presse, puis la radio à partir des années 1920. Dès 1911 toutefois, une salle de cinéma est dédiée au sport. Il s’agit Biograph-sports, dont l’objectif est de présenter des « films, exclusivement sportifs, [qui ne peuvent] manquer de plaire aux si nombreux passionnés de sport [1] ». Les actualités cinématographiques offrent aussi aux amateurs de football l’occasion de découvrir en images les vedettes de leur sport préféré.
-
Lire l’article En 1928, les débuts de l’équipe de France à la radio
Des séances de cinéma spéciales football sont parfois organisées, comme en 1924, où la FFFA (ancêtre de la FFF) présente un film détaillant les phases essentielles du football, avec la contribution de nombreux internationaux. La séance se conclue avec la projection du match France Belgique du 13 janvier [2]. En 1929, la Fédération Français organise à nouveau une soirée consacrée au football, avec la projection des films Fleming puis les onze diables [3].
Le journal L’Auto possédant sa propre salle de cinéma propose le 20 mars 1935 la projection du match France-Allemagne joué quelques jours plus tôt, permettant à ceux qui n’ont pu aller au stade de se rendre compte de l’ambiance du stade, de la qualité des joueurs allemands, et aussi des approximations des Français, en dépit de leur victoire (1-0) [4].
-
L’Auto du 21 mars 1935 (BNF, Gallica)
Si la télévision est apparue en France le 26 avril 1935, il n’y a encore qu’une heure et 38 minutes de programmes journaliers en 1948, alors que le coût d’un poste représente 6 mois de salaire d’un ouvrier. Ce n’est que dans la deuxième moitié des années 1950 que les foyers français vont commencer à s’équiper, le parc passant d’environ 125 000 postes en 1954 à environ 2 millions en 1960.
Le journal télévisé apparaît le 29 juin 1949 et s’appuie en grande partie sur le sport [5]. Un résumé de France-Yougoslavie y est proposé le 28 octobre 1949. En 1950, les trois rencontres disputées en France font l’objet d’un reportage au JT. En 1951, trois des cinq rencontres jouées à l’extérieur (Gênes, Londres et Genève) sont traitées au JT tout comme les France-Yougoslavie et France-Autriche qui se déroulent en région parisienne [6]. Mais les choses se compliquent rapidement, car la Fédération et le Groupement (ancêtre de la LFP) craignent que la télévision ne vide les stades en cas de transmission en direct.
-
L’Equipe du 4 octobre 1952 (BNF, Gallica)
Un premier France-RFA après la guerre qui suscite la passion du public
Des réunions sont prévues dès 1951 entre le Groupement et la Télévision pour se pencher sur la question. A quelques jours du match France-RFA, et quelques mois après la diffusion en direct de la finale de la coupe de France, de nombreuses questions se posent. La FFF autorise la diffusion en direct de la rencontre, mais ne semble pas vouloir en faire une habitude sans compensation financière. De plus, face à l’afflux de supporters étrangers pour le match, une agence de voyage envisage de retransmettre la rencontre dans une salle de spectacle [7].
Cependant, Pierre Sabbagh, directeur de la télévision française, explique que ce projet n’est pas réaliste pour des questions techniques [8]. Le projet ne peut se concrétiser, mais on note que le premier match de l’équipe de France télévisé aurait pu s’accompagner d’un premier écran géant. L’engouement pour le match génère toutefois près de 1200 achats de téléviseurs dans les jours précédant le match [9].
La rencontre est un succès aussi bien sportif (victoire des Français 3-1), que financier. La recette pour match de football a été battue. Les 56 021 spectateurs laissent en effet un total de 18 295 000 aux guichets, battant les 17 239 727 francs de la finale de la coupe de France 1952, également diffusée (61 722 spectateurs) [10]. Ces éléments sont donc un contre argument à ceux qui prétendent que la télévision va vider les tribunes des stades.
-
L’Equipe du 6 octobre 1952 (BNF, Gallica)
Une prestation mitigée du reporter Georges Briquet
Aucun commentaire n’est fait dans le journal L’Equipe sur la retransmission du match. Cependant, la thèse d’histoire de Jean-Christophe Meyer sur les débuts du football à la télévision en France et en RFA [11] nous apporte de nombreux éclairages sur le sujet [12]. La prestation du commentateur Georges Briquet est saluée dans Le Monde dans les jours suivants le match [13] : « Ce France-Allemagne a enfin marqué les débuts de Georges Briquet commentateur de télévision. A ceux qui accusaient parfois le radioreporter d’en prendre un peu à son aise avec la réalité et de laisser trop libre cours à son imagination, Georges Briquet a répondu preuve en main, c’est-à-dire à l’écran sous les yeux de façon éclatante. Quelle justesse et quelle vélocité ! Voilà en résumé qui augure fort bien des reportages en direct du dimanche que l’on nous promet. »
Le film du match n’a pas été archivé, mais il reste le résumé passé le soir même au JT, avec, semble-t-il les commentaires du direct [Voir sur le site de l’INA]. L’analyse de ces commentaires donne toutefois un aperçu différent de l’analyse remontée dans Le Monde. La principale difficulté est que Briquet raconte le match que tout le monde voit, plutôt que d’apporter une expertise. Il a également tendance à s’emballer, décrivant par exemple un tir anodin allemand sur lequel le gardien français n’a qu’à se mettre à genou pour récupérer le ballon comme « un audacieux plongeon. »

Et ensuite ?
En dépit de cette première réussie, la relation foot-télévision ne va pas s’améliorer dans les années qui suivent. Il faut attendre le 11 juin 1953 (France-Suède) pour que les Tricolores aient à nouveaux les honneurs du direct. Deux rencontres sont diffusées en 1954 (Yougoslavie en juin, RFA en octobre). Les supporters de l’équipe de France n’ont ensuite qu’une seconde mi-temps en différé à se mettre sous la dent en 1955 (Yougoslavie, 11 novembre) tout comme en 1956 (Belgique, toujours le 11 novembre). Un direct est proposé en 1957 (Angleterre), puis trois en 1958 (Espagne puis Brésil et RFA lors de la coupe du monde) ainsi que deux secondes mi-temps en différés (RFA et Italie).
Les choses ne s’arrangent pas en 1959 (le dernier quart d’heure en direct du match contre le Portugal, puis la rencontre face à l’Espagne). En 1960, la première édition du championnat d’Europe n’est même pas proposée, la RTF lui préférant le tour de France. Ce n’est qu’à partir de 1963 que les matchs commenceront à être régulièrement retransmis avec toutefois de nombreux conflits et déprogrammations de dernière minute et il faut attendre le milieu des années 1970 pour que l’équipe de France de football s’invite de manière quasi-systématique dans les salons des Français.